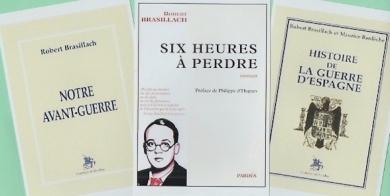
Camille Galic, journaliste, auteur, essayiste.
♦ Rééditée pour le 71e anniversaire de son exécution le 6 février 1945 au fort de Montrouge, Six heures à perdre est la dernière œuvre de Robert Brasillach, publiée à titre posthume chez Plon en 1953 et largement méconnue. Mais s’agit-il vraiment d’un roman comme la présente l’éditeur, « d’un grand roman de l’Occupation, un des plus grands qui soient, malgré l’abondance d’œuvres sur le sujet », insiste son préfacier ? On peut considérer aussi que l’écrivain s’efface ici devant le journaliste pour nous donner un formidable reportage, criant de vérité.
Si son pays lui « fait mal », Brasillach (1) observe une totale neutralité sur le quotidien des prisonniers en Allemagne et celui des Français pendant les « heures les plus sombres ».
C.G.
Dans son érudite préface à ce livre, Philippe d’Hugues (2) rappelle que, préfaçant ce livre dans le tome III des Œuvres complètes de Brasillach parues au Club de l’honnête homme, son ami de la rue d’Ulm et beau-frère Maurice Bardèche affirmait que, « des trois parties que comporte l’ouvrage, c’est la première qui est la meilleure, alors que la troisième lui semble la moins réussie ». Ph. d’Hugues pense « exactement le contraire », trouvant « monotone » l’évocation « insistante » de la captivité de l’écrivain, alors que la deuxième partie intitulée « La Permission » lui semble « scintillante », une « petite merveille, du pur Brasillach d’avant-guerre », tout comme la troisième partie, « Le Drapeau noir », est « la grande réussite du roman ».
Oserai-je dire que les trois parties me paraissent indissociables et également prenantes ? D’abord, l’argument romanesque : enfin libéré de son Oflag, un officier dont on ne saura rien occupe ses « six heures à perdre » entre deux trains à retrouver l’énigmatique Marie-Ange, rencontrée par son camarade de captivité Bruno Berthier à la faveur d’une permission pendant la drôle de guerre et qui dévoilera peu à peu tous ses mystères. Mais cet argument est surtout la justification d’un documentaire sur le contraste entre l’univers cloîtré du camp et celui, tout aussi étouffant, de la « vraie vie » sous l’Occupation. A l’appui de cette impression, le fait que le style de Brasillach – qui fit paraître ce récit en feuilleton dans Révolution nationale au printemps 1944 avant d’en corriger les épreuves à la veille de son arrestation – se fait moins fluide, moins littéraire. La « petite musique » demeure, mais l’ancien normalien ne recule pas devant les répétitions (il emploie par exemple deux fois le verbe aimer en une ligne) et néglige quelquefois l’imparfait du subjonctif. Oubliée la virtuosité, il veut que sa plume colle au plus près à l’authenticité, rende au plus juste les sensations éprouvées, les portraits qu’il esquisse, les situations qu’il décrit sans esprit partisan, sauf peut-être quand il campe ces « grosses crémières et bouchères » endiamantées grâce au rationnement… et dont se souvint sans doute Jean Dutourd quand il écrivit Au bon beurre huit ans plus tard.
Après la défaite, Brasillach resta jusqu’en 1941 prisonnier à l’Oflag VI A de Soest, en Westphalie. Il n’en garda pas un si mauvais souvenir puisque, écrit le narrateur qui pourrait se prénommer Robert, le temps passé là a « ressemblé un peu à ma vie d’étudiant ». Promiscuité mais aussi camaraderie, promenades interminables autour du Marschfeld, plaisirs « communs et certains », ingéniosité infinie pour cuisiner des plats raffinés sur des fourneaux improbables (entre deux briques, on fait un foyer élémentaire et on pousse dessous des « bandes de papier » pour fricoter un « civet magnifique » à partir d’un « matou imprudent »), ou monter des spectacles « qui eussent honoré les plus hardies des compagnies parisiennes ». Car « lorsqu’on vit retiré du monde, c’est l’imagination qui devient la reine », qu’il s’agisse de « cristalliser » de manière très stendhalienne une rencontre à première vue éphémère, comme celle du permissionnaire Berthier avec Marie-Ange, ou d’élaborer des tentatives d’évasion. Le narrateur évoque ainsi deux « esprits ingénieux » qui s’étaient confectionné un uniforme feldgrau en papier pour passer inaperçus. Leur belle échoua mais « les Allemands rirent beaucoup, les félicitèrent et leur demandèrent l’autorisation de les photographier ».
Le temps du dégoût
Pour dépeindre l’Oflag et l’état d’esprit y régnant reviennent en leitmotive les termes naïf, naïveté, naïvement : afin d’exprimer le retour à une certaine innocence et la relative infantilisation d’hommes faits tout à coup privés de leurs responsabilités professionnelles et familiales ? ou pour exprimer le contraste cruel entre la discipline et la camaraderie du camp, où chacun se réjouissait de la libération d’un compagnon de chambrée, et les arrangements en tout genre et l’aliénation aboutissant au total « confusionnisme », « des idées et des instincts », dans lequel s’embourbaient et souvent se perdirent des civils prêts à croire à tous les miracles mais aussi à toutes les calomnies ? « Temps du dégoût », né « de la hargne, de la violence, des menaces souvent mises à exécution, de la plus complète intolérance », du « mélange bizarre qui se faisait ici de sentiments désintéressés et d’affaires, tout ce salmigondis de révolte et de marché noir, de banditisme sans aveu, d’idéalisme dévoyé ».
Mais d’un même regard, distancié et pourtant presque empreint de tendresse, le narrateur décrit les jeunes séduits par l’Ordre nouveau et, à l’opposé, leurs contemporains trotskistes ou anars parmi lesquels évolue sans préjugés Marie-Ange, malheureux entraînés « vers de si noires alliances, noires et sordides ». Mais ainsi allait sans doute l’Occupation avec ses profiteurs et ses sacrifiés, ses salauds et ses héros courant vers « de belles morts dignes et graves, plus belles que la vie n’avait été, car il est plus facile de bien mourir que de bien vivre ».
Propos prémonitoire ? Et prémonition aussi que le titre du récit, Six heures à perdre ? Six heures, c’est ce qui suffit le 19 janvier 1945 à la Cour d’assises de la Seine devant laquelle était déféré Robert Brasillach – qui s’était constitué prisonnier en septembre 1944, après avoir appris l’arrestation de sa mère et de Maurice Bardèche – pour examiner son cas, le déclarer coupable d’intelligence avec l’ennemi et le condamner à mort… après vingt minutes à peine de délibération. Charles De Gaulle, qui avait refusé sa grâce, devait ensuite écrire dans ses Mémoires, à propos du supplicié de Montrouge, que « le talent est un titre de responsabilité ».
Six heures à perdre doit sa réédition à l’Association des amis de Robert Brasillach (3).
Camille Galic
12/02/2016
Robert Brasillach, Six heures à perdre, éditions Pardès, janvier 2016, 256 pages.
(1) Voir le poème de Robert Brasillach, «Mon pays m’a fait mal» dans Poèmes de Fresnes (dit par Pierre Fresnay).
(2) Auteur de Brasillach, éditions Pardès, 2005, collection Qui suis-je ? 128 pages.
(3) Association des Amis de Robert Brasillach, Case Postale 3563, 1211 Genève 3, Suisse (www.brasillach.ch). Le livre est disponible sur le site : www.librairiefrancaise.fr
Correspondance Polémia – 14/02/2016

