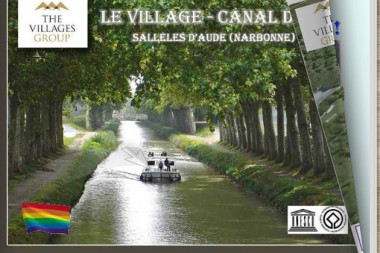Mardi 30 juillet 2013, midi. Heureusement il nous reste la lumière — la lumière et l’amour (mais certaines philosophies soutiennent que c’est la même chose, je crois).
La vieille consolation lamartinienne par le truchement de la nature (Mais la nature est là qui t’invite et qui t’aime), celle de toute la poésie lyrique au moins jusqu’au siècle dernier, n’est plus si agissante, loin de là. La nature n’est plus là, ou bien rarement, et dans quel état ! Elle est partout humiliée, blessée, salie, souillée, aménagée, viabilisée, rentabilisée, touristisée, tôllifiée, parpaingnifiée, industrialisée, banlieucalisée, artificialisée, peaudechagrinée, traquée. Il n’y a que les gens qui ne l’aiment pas vraiment pour ne pas voir ses atroces souffrances et pour jouir sereinement de son agonie. Il n’y a que les gens qui n’aiment pas le paysage (et ils sont l’immense majorité des vivants, il suffit de les voir ne pas le voir, et de voir comment ils le traitent) pour croire que le paysage nous offre la ressource qu’il a toujours offerte — le toujours très historique du sentiment lyrique, au moins. Aimer le paysage c’est comme aimer la langue, ou comme aimer la France : une blessure de tous les instants. Oh, certes, il nous reste des lambeaux, de magnifiques vestiges, des poèmes, des terrasses, des livres, des vergers, des fenêtres, des îles, des inscriptions sur des pierres, le coin d’un champ et même quelques morceaux de montagne réchappés par miracle à la sale industrie des sports d’hiver ; mais pratiquement plus de bords de mer, presque jamais de grands panoramas intacts, à peine un ou deux villages épargnés par la Grande Pelade, l’arrachage des enduits, la lèpre pavillonnaire, l’éclairage a giorno et, s’ils ont eu le malheur d’être trop beaux, la kitscherie gnan-gnan, le fer forgé, l’artisanat d’art, l’esprit “poutres app.”, les galeries de peinture, les “formules”, le second degré.
J’ai eu l’imprudence de faire confiance aux ciels. Ils ont longtemps été loyaux et sûrs. Il leur arrive encore de nous mettre à genoux, d’admiration et de gratitude. Mais mêmes eux sont pollués à présent, maculés, striés, lacérés par cet imbécile d’homme et son ingénieux génie. Ne nous laissera-t-il pas, à la fin, un seul espace et un moment sans lui ? Faut-il vraiment qu’il humanifie, quand bien même il les aurait déjà si heureusement humanisés, chacun de nos regards et la moindre de nos sensations ?
Heureusement il reste la lumière. Ce matin au lever la lumière était si belle, dans cette pièce haute, fenêtres grand ouvertes sur la canopée jusqu’aux montagnes, qu’on était consolé de tout, lavé, embaumé, rasséréné, apaisé, consolé, guéri. Sprich zu mir, Geliebter ! Une otite à l’oreille droite me fait méchamment souffrir depuis trois jours, jamais à ce rythme je n’aurai fini pour la fin août ce volume francilien des Demeures, mon compte en banque est à découvert depuis vingt-neuf jours, tous les matins ou presque je suis réveillé par une suspecte douleur au bas-ventre, le chien de la voisine va me rendre fou, Manuel Valls estime que le ramadan fait partie intégrale du calendrier français (comme le festival de Cannes, Roland-Garros et le Tour de France, sans doute…), les prélèvements automatiques mensuels vont être refusés, mon rein droit ne se laisse pas un moment oublier, je n’arrive pas à répondre aux lettres et à remercier des livres qu’on m’envoie, le parti de l’In-nocence risque de ne pas pouvoir aligner de candidats partout, dans ces conditions des coliques néphrétiques ne m’étonneraient pas, Pierre est allé pour rien chercher Farid à la gare d’Agen, de tous les contributeurs de “Boulevard Voltaire” je suis celui qui intéresse le moins les lecteurs. « On s’en fout ! », commente gracieusement un commentateur sous mon entrée d’hier, à l’instant. Sans doute, sans doute, bien sûr, le contraire m’aurait étonné — mais quelle belle lumière !
Ce n’est même pas assez de dire qu’elle est belle, on jurerait aussi qu’elle est bonne, tendre, sororale, pleine de sollicitude et d’amour.
La lumière n’a pas assez de bras pour nous porter, dit une pièce de Gérard Pesson pour piano amplifié. Elle date de 1994 et elle est dédiée, comme Stèles, de Grisey, dont je parlais il y a deux ou trois jours, à la mémoire de Dominique Troncin. Le titre est emprunté à un poème monostiche de Pierre-Albert Jourdan, dans Sandales de paille. Jourdan, quelque temps avant de mourir, clôt ses Carnets par ces deux phrases :
« Au fond, on a beaucoup marché. Déjà heureux de ne pas s’être perdu plus vite. »
« On s’en fout ! », dit M. Cédric Troissou — au fond le message de ce critique n’est peut-être pas si éloigné des enseignements de la lumière ; même si elle, n’ayant pas de bras pour nous porter, ni de bouche pour nous parler, use, par définition, d’un silence plus châtié.
Ainsi que m’en adjurait à juste titre un autre commentateur peu amène, la semaine dernière :
« Et ne répondais pas, surtout ! »
Je m’en garderez bien.
Mehr Licht !
En exclusivité sur BOULEVARD VOLTAIRE